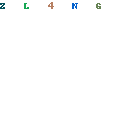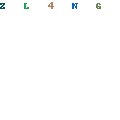‘J’avais une seule chaussure’: le ministre Jean De Dieu raconte comment sa vie a changé voici les détails
De son case à Bafou à son cabinet de ministre délégué Chargé de la Justice, on peut dire que Jean De Dieu Momo a fait du chemin. Dans une publication aux allures d’un témoignages, l’avocat qui est rentré au gouvernement, raconte comment sa vie a changé et comment le Cameroun évolue, malgré les ‘lamentations’ des activistes sur la toile.
—
« L’histoire que je vais narrer ici est votre propre histoire. Je suis né au 20ème siècle et plus précisément le 24 janvier 1960 à Bafou. Je vis actuellement au 21ème siècle. Je suis donc qualifié pour témoigner des changements qui se sont opérés au Cameroun sous mes yeux, en l’espace de 60 ans. Bafou est un grand village de la Menoua où régnait en ce temps-là un Roi intellectuel, le Docteur Paul Kana II, Médecin qui avait lui-même pris la succession de son père le Roi NGOUADJIO Jean, assassiné par les maquisards parce qu’il ne voulait pas entrer avec eux en rébellion contre le président Ahidjo. Il suivait en cela les traces de son propre père, le Roi Kana 1er, mon ancêtre direct, qui avait accueilli les allemands dans notre Royaume, ce qui lui avait évité de subir le sort funeste de certains Rois qui avaient été pendus.
Dans notre village, le seul endroit qui avait l’électricité était le Collège Saint Laurent, un collège de la Mission Catholique, qui était alimenté par un groupe électrogène. Je garde le souvenir impérissable de l’immense cloche de l’église que seuls quelques privilégiés avaient l’autorisation de faire sonner, en nous accrochant de toutes nos forces à la corde et la tirer pour la faire tinter. En dehors de ce petit paradis, nous nous éclairions tous à la lampe à pétrole. à la lueur de laquelle j’étudiais mes leçons et il arrivait que le pétrole finisse dans la lampe pendant ma lecture, alors je faisais monter la mèche pour pouvoir étancher ma soif de la lecture. C’est en tout cas ce que je laissais croire à ma mère, une belle analphabète, car en réalité c’était le plus souvent pour achever de lire une page de ma bande dessinée ou des romans dont je raffolais alors. Ma mère n’y voyait que du feu et elle m’aurait massacré si elle avait su l’usage ludique que je faisais de son précieux pétrole (kérosène).
Pour tout le département de la Menoua qui compte six Arrondissements aujourd’hui, il n’y avait que deux établissements scolaires post primaires : le Collège Saint Laurent de Bafou et le Collège d’Enseignement Général de Dschang (CEG), un établissement public. L’école Saint Thomas où mes parents m’avaient inscrit jouxte le Collège Saint Laurent. Il était à environ 5 km de notre maison et il fallait partir très tôt le matin, à pied, au pas accéléré, si on ne voulait pas arriver en retard.
En ce temps-là, nous écrivions parfois à la Plume trempée dans de l’Encre. C’était des accessoires indispensables pendant le cours d’Ecriture. Parfois l’Encre tâchait le cahier et il fallait utiliser le buvard pour la faire sécher. Au Cours d’arithmétique, nous apprenions à compter grâce aux bâtonnets que nous fabriquions nous-mêmes, avec la tige des herbes hautes ou des brindilles cassé dans le bambou. Chaque élève avait son petit fagot de vingt à cinquante bâtonnets, bien attachés par une fine corde pour ne pas en égarer un. Le Bic n’existait pas encore sous sa forme actuelle, mais il y avait des stylos à bille de provenance étrangère, surtout française. C’est un industriel camerounais qui fabriquera plus tard le stylo à bille que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de BIC.
Comme l’école était éloignée de notre maison, ma mère mettait dans mon sac une assiette attachée dans un foulard, qui contenait mon repas de midi.À l’instar des autres élèves de la même condition que moi, je plaçais mon assiette-repas dans un coin de la salle de classe et, à midi, lorsque ceux des camarades qui habitaient non loin de l’école rentraient chez eux pour la pause, je prenais mon repas, assis devant la classe, et mettais à profit le temps de ma pause pour rendre visite au vieux forgeron à côté de l’école qui me laissait jouer avec les soufflets pour faire rougir le fer sur le feu pendant qu’il m’apprenait à fabriquer des couteaux de cuisine dans sa forge.
Mon père, un fervent croyant de l’église catholique romaine, m’avait inscrit au cours du catéchisme, pour apprendre à connaitre Dieu. J’étais fasciné par l’histoire de la création du monde en six jours et le repos du septième jour. Je rêvassais devant la pile d’assiettes et de marmites que je lavais, accroupi devant la porte de la cuisine de ma mère, pour le repas du soir, en m’interrogeant sur l’existence de Dieu et le mystère de la création. J’avoue que jusqu’aujourd’hui la question du premier élément de l’apparition de la vie sur terre me turlupine toujours. Ils ont dit que c’est un mystère. Je le crois, faute d’autre explication.
Avec mon frère Valentin, nous allions faire provision d’eau au marigot situé au bas fond. Nous étions les seuls garçons à la maison et notre principale tâche se limitait à puiser de l’eau et à laver les assiettes et les marmites. Les filles, mes sœurs, faisaient la cuisine avec maman et l’accompagnaient cultiver aux champs. Cependant nous n’en n’étions pas épargnés, puisqu’elle pouvait décider, à volonté, que nous allions l’accompagner dans le champ de Nzih situé à 8 km de la maison. Et là, il fallait se lever en pleine nuit, marcher dans la nuit, en dormant, en bougonnant, en maugréant jusqu’au champ où il arrivait que la pluie vint s’ajouter à mon malheur déjà bien grand.
Valentin était plus stoïque. Il ne gémissait jamais. Moi je protestais quand je ne pleurais pas simplement, surtout pendant la corvée d’eau. Mon seau plastique de dix litres avait une sorte de bosse en son milieu, qui creusait douloureusement le sommet de mon crâne, comme un clou qui s’y enfonçait. J’avais le sentiment que mon cou allait se briser en même temps, puisque j’étais obligé de pencher la tête dans tous les sens pour échapper à la lancinante douleur.
Une fois, pour éviter « le seau de torture », je m’étais cru rusé de choisir la bassine grise en inox pour aller puiser de l’eau à la rivière et, me croyant le plus malin, j’avais mis de l’eau à moitié dans la bassine. Mal m’en avait pris puisque l’eau se balançait dans la bassine et imprimait son mouvement en moi, m’obligeant à marcher en dandinant, un pas en avant, un autre en arrière, le suivant sur le côté, au gré du balancement de l’eau dans la bassine. Mes pleurs n’y pouvaient rien changer. Heureusement que papa Thaddée qui passait par là, avait tenu ferme la bassine pour l’empêcher d’aller dans tous les sens. Il m’avait ainsi accompagné jusqu’à la maison. Je n’avais plus réédité cet exploit qui m’avait instruit par lui-même qu’il faut toujours faire le plein de la bassine pour éviter que l’eau vous imprime son mouvement, et j’ai repris stoïquement mon « seau de torture ».
Mon père m’avait acheté une belle paire de chaussures en plastique au magasin Bata dont la publicité recommandait : « Pas un pas sans Bata ». Elle sentait si bon le plastique dans son carton blanc. J’étais très heureux. Beaucoup de mes camarades ne portaient pas de chaussures et allaient pieds-nus à l’école. C’était d’ailleurs mon unique paire de chaussures. Et quand elle se déchirait, je mettais un couteau à rougir sur le feu de bois pour la recoller, et le couteau rougi faisait sortir de la fumée blanche au contact du caoutchouc.
J’aimais beaucoup le parfum du carton blanc de mes chaussures neuves en plastique et je décidais de transférer le contenu de mon sac de classe dans ce carton pour aller à l’école. Malheureusement, lorsque je traversais le pont en bambou jeté sur le cours d’eau, dans le bas fond, les lianes qui liaient ensemble le fagot de bambous jetés sur la rivière pour servir de pont étaient coupées par l’usure, de sorte qu’il fallait jouer aux équilibristes sur le tas de bambous pour passer de l’autre côté de la rivière.
Mon carton blanc avait l’inconvénient de ne pas avoir de cordes pour l’arrimer en bandoulière à mon cou comme je le faisais de mon sac de classe en fibre de feuilles de bambou, de sorte que j’avais besoin de mes deux mains pour le tenir. Mes pieds trempés dans l’eau, à cause de la flexibilité des bambous éparpillés, glissèrent. Je tombai et me répandis de tout mon long dans l’eau froide du matin. Je barbotais désespérément pour, à la fois, reprendre mon équilibre et sauver mes effets scolaires trempés. Mais le mal était déjà fait. Mes cahiers étaient mouillés. Naturellement j’arrivais en retard en classe tout trempé et dégoulinant d’eau. Devant mon air misérable et pitoyable, le maître, Monsieur Deferre, ne m’infligea pas la punition du fouet et m’autorisa, sourire en coin, à aller m’asseoir, sous les regards ravis et moqueurs de mes camarades.
Aujourd’hui le programme audacieux de l’électrification rurale entrepris par les pouvoirs publics suit son cours avec bonheur, et presque tout mon village est doté de l’électricité, comme beaucoup d’autres villages à travers le Cameroun. Des forages d’eau naissent ici et là pour approvisionner les zones rurales en eau potable. De nombreuses écoles ont été construites pour rapprocher l’école des écoliers. Il y a aujourd’hui plus d’une trentaine de Lycées dans le Département de la Menoua et autant d’Etablissements d’Enseignements privés et publics. De nombreuses routes et ponts ont été construits, au grand bonheur des populations. Jamais, au grand jamais, nous ne nous étions plaints, comme j’entends de nos jours nos enfants, du manque d’eau potable ou de l’électricité. Nous allions puiser de l’eau au marigot et nous nous éclairions à la lampe tempête !
Parfois on n’avait même pas des allumettes pour faire un feu de bois. Aussi on fendait des bambous d’une longueur d’un mètre environ, pour aller quémander du feu chez le voisin, en guise de torche. Le feu était en effet une denrée rare qu’il fallait garder précieusement comme il est décrit dans la légende de Prométhée parti voler du feu. Il y avait une technique pour garder le feu consistant à enterrer les braises ardentes sous la cendre et on les réactivait le lendemain pour refaire du feu pour la cuisine ou pour se réchauffer.On n’avait pas de réchaud à gaz, ni de téléphone, portable ou fixe. Ni internet, ni Whatsaap, ni Facebook. On envoyait nos lettres par la poste avec « le courrier postal » et elles commençaient toujours par «Cher Papa, grande est ma joie de t’écrire cette lettre pour te saluer et demander l’état de ta santé actuelle. En effet… »
Nous étions heureux avec ça et n’avions jamais SU que nous étions PAUVRES. Aujourd’hui, on nous apprend que nous l’étions, que nous sommes même pauvres. Je n’y crois pas. Nous étions heureux, très heureux même. Nous allions gaiement à travers champs pour marauder les fruits, ramasser les œufs de perdrix, donner la chasse aux oiseaux et aux rats. Et nous étions si glorieux au retour de nos escapades avec un gibier, sauf bien sûr quand j’avais laissé échapper le rat, à la grande colère de Valentin et de nos amis. Pour jouer au football, nous faisions de grosses boules de feuilles séchées de bananier que nous tenions par des ficelles et c’était un bon ballon de football derrière lequel nous organisions des compétitions avec les garçons du voisinage. Je ne suis pas certain qu’il y avait au monde quelqu’un de plus heureux que nous, à barboter dans la marre ou à skier dans la boue pendant la saison de pluie.
Certes nous ne portions pas toujours des chaussures, et en saison sèche, lorsque le soleil chauffait la terre au point qu’elle se fendillait par endroit, la chaleur brûlait la plante de mes pieds-nus. Nous étions heureux « MALGRE » ( avec) tout cela.
Qui veut nous faire croire aujourd’hui que nous sommes malheureux et que le bonheur se mesure au matériel selon les valeurs importées de l’étranger? Et dans quel objectif funeste veut-on nous faire croire cela ?Qu’avons-nous fait à nos enfants qui revendiquent aujourd’hui Eau et Electricité alors qu’ils ont tout ce que nous n’avons pas eu? (« l’eau sort du mur » s’écriait le chanteur !). Pourquoi sont-ils si malheureux avec tout ce qui leur a été donné alors que nous étions si heureux sans tout cela ?
J’ai entendu dire que la stratégie de certains de nos concurrents internationaux serait de concevoir et de diffuser des idéologies pour faire croire aux africains qu’ils sont pauvres, et que c’est de leur faute s’ils sont pauvres et surtout que c’est de la faute de leurs parents ou de leurs dirigeants. C’est à ce projet que notre peuple semble prêter le flanc à l’insu de son intime conviction. Il est dirigé adroitement vers la course au fauteuil présidentiel plus que par le bien-être de tous et de chacun, au prétexte de la démocratie de l’alternance! La mise en route de ce plan semble être une réussite totale puisque notre jeunesse ne voit plus désormais qu’avec les yeux des étrangers et ne pense plus qu’avec leurs cerveaux, ayant embrassé leurs valeurs au détriment des nôtres. Elle est désormais sous hypnose et nous combat férocement, comme le hanneton(Foss chenille blanche) qui mangeait son corps en croyant manger le raphia. Nous désespérons de la réveiller pour qu’elle réalise qu’elle fait l’objet d’un plan stratégique d’appauvrissement et de conquête de l’Afrique, sous la forme du cheval de Troie par le procédé du dénigrement systématique de nos pays.
Le Président Kadhafi en a été victime mais la jeunesse africaine continue son aveuglement politique. Le réveil se trouve dans le changement de nos mentalités à travers le Mindset ou le Mind Education qui nous fera voir les choses d’une manière différente et nous conduira à transformer notre pauvreté en richesse et nos difficultés en opportunités d’amélioration de nos conditions de vie ».